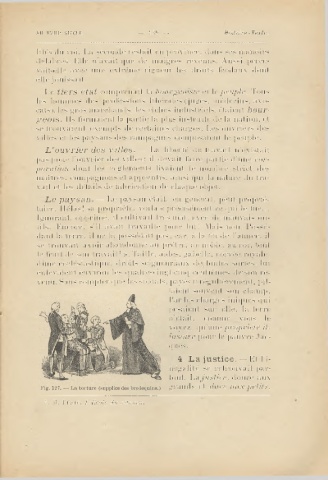Page 147 - Histoire de France essentielle
P. 147
AD XVIII» SIÈCLE. — 139 — Histoire-Texte.
lités <lu roi. La seconde restait en province, dans ses manoirs
délabrés. Elle n’avait que de maigres revenus. Aussi perce
vait-elle avec une extrême rigueur les droits féodaux dont
(die jouissait.
Le tiers état comprenait la bourgeoisie et le peuple. Tous
les hommes des professions libérales (juges, médecins, avo
cats),les gros marchands, les riches industriels, étaient bour
geois. Ils formaient la partie la plus instruite de la nation, et
se trouvaient exempts de certaines charges. Les ouvriers des
villes et les paysans des campagnes composaient le peuple.
L’ouvrier des villes. — La liberté du travail n’existait
pas pour l’ouvrier des villes; il devait faire partie d’une cor
poration dont les règlements fixaient le nombre strict des
maîtres, compagnons et apprentis, ainsi que la nature du tra
vail et les détails de fabrication de chaque objet.
Le paysan. — Le paysan était, en général, petit proprié
taire. Hélas! sa propriété, voilà « précisément ce qui le tue...
Ignorant, opprimé, il cultivait très mal, avec de mauvais ou
tils. Encore, s’il avait travaillé pour lui! Mais non. Possé
dant la terre, il ne la possédait pas; car, à la lin de l’année, il
se trouvait avoir abandonné au prêtre, au noble, au roi, tout
Je fruit de son travail1 ». Taille, aides, gabelle, corvée royale,
dîme ecclésiastique, droits seigneuriaux de toutes sortes, lui
enlevaient environ les quatre-vingt-cinq centièmes de'son re
venu. Sans compter que les soldats, payés irrégulièrement, pil
laient souvent son champ.
Par les charges iniques qui
pesaient sur elle, la terre
n’était, comme vous le
voyez, qu’une propriété il
lusoire pour le pauvre Jac
ques.
4. La justice. —Et l’i
négalité se retrouvait par
tout. La justice, douce aux
grands et dure aux petits,
1. R. Pékié, L'École du citoyen.