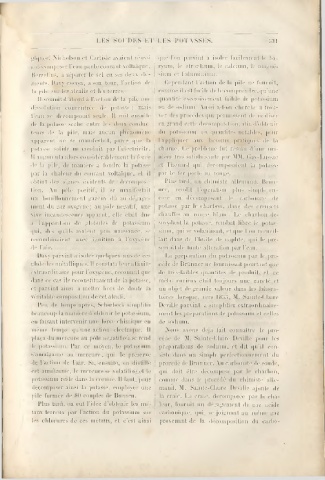Page 535 - Les merveilles de l'industrie T1
P. 535
LES SOUDES ET LES POTASSES. 531
giqucs. Nicholson et Carliste avaient réussi que l’on parvint à isoler facilement le ba
à décomposer l’eau par le courant voltaïque ; ryum, le strontium, le calcium, le magné
Berzélius, à séparer le sel en ses deux élé sium et l’aluminium.
ments. Davy essaya, à son tour, l’action de Cependant l’action de la pile ne fournit,
la pile sur les alcalis et les terres. comme il est facile de le comprendre, qu’une
Il soumit d’abord à l’action de la pile une quantité excessivement faible de potassium
dissolution concentrée de potasse ; mais ou de sodium. Aussi a-t-on cherché à trou
l’eau se décomposait seule. 11 mit ensuite ver des procédés qui permissent de réaliser
de la potasse sèche entre les deux conduc en grand cette décomposition, afin d’obtenir
teurs de la pile, mais aucun phénomène du potassium en quantités notables, pour
apparent ne se manifestait, parce que la l’appliquer aux besoins pratiques de la
potasse solide ne conduit pas l’électricité. chimie. Ce problème fut résolu d’une ma
Il augmenta alors considérablement la force nière très-satisfaisante par MM. Gay-Lussac
de la pile, de manière à fondre la potasse et Thénard qui décomposaient la potasse
par la chaleur du courant voltaïque, et il par le fer porté au rouge.
obtint des signes évidents de décomposi Plus tard, un chimiste allemand, Brün-
tion. Au pôle positif, il se manifestait ner, rendit l’opération plus simple en
un bouillonnement gazeux dû au dégage core en décomposant le carbonate de
ment du gaz oxygène ; au pôle négatif, une potasse par le charbon, dans des creusets
vive incandescence apparut; elle était due chauffés au rouge ’ blanc. Le charbon dé-
à l’apparition de globules de potassium soxydant la potasse, rendait libre le potas
qui, dès qu’ils avaient pris naissance, se sium, qui se volatilisait, et que l’on recueil
recombinaient avec ignition à l’oxygène lait dans de l’huile de naphte, qui le pré
de l’air. servait de toute altération par l’eau.
Davy parvint à isoler quelques-uns de ces La préparation du potassium par le pro
globules métalliques. Il constata leur affinité cédé de Brünner ne fournissait pourtant que
extraordinaire pour l’oxygène, reconnut que de très-faibles quantités de produit, et ce
dans ce cas ils reconstituaient de la potasse, métal curieux était toujours une rareté et
et parvint ainsi à mettre hors de doute la un objet de grande valeur dans les labora
véritable composition de cet alcali. toires lorsque, vers 1855, M. Sainte-Claire
Peu de temps après, Schœbeck simplifia Deville parvint à simplifier extraordinaire
beaucoup la manière d’obtenir le potassium, ment les préparations de potassium et celles
en faisant intervenir une force chimique en de sodium.
même temps qu’une action électrique. Il Nous avons déjà fait connaître le pro
plaça du mercure au pôle négatif où se rend cédé de M. Sainte-Claire Deville pour les
le potassium. Par ce moyen, le potassium préparations de sodium, et dit qu’il con
s’amalgame au mercure, qui le préserve siste dans un simple perfectionnement du
de l’action de l’air. Si, ensuite, on distille procédé de Brünner. Au carbonate de soude,
cet amalgame, le mercure se volatilise et le qui doit être décomposé par le charbon,
potassium reste dans la cornue. Il faut, pour comme dans le procédé du chimiste alle
décomposer ainsi la potasse, employer une mand, M. Sainte-Claire Deville ajoute de
pile formée de 80 couples de Bunsen. la craie. La craie, décomposée par la cha
Plus tard, on eut l’idée d’obtenir les mé leur, fournit un dégagement de gaz acide
taux terreux par l’action du potassium sur carbonique, qui, se joignant au même gaz
les chlorures de ces métaux, et c’est ainsi provenant de la décomposition du carbo