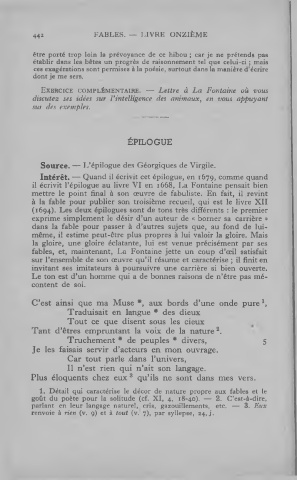Page 446 - Les fables de Lafontaine
P. 446
442 FABLES. — LIVRE ONZIÈME
être porté trop loin la prévoyance de ce hibou ; car je ne prétends pas
établir dans les bêtes un progrès de raisonnement tel que celui-ci ; mais
ces exagérations sont permises à la poésie, surtout dans la manière d’écrire
dont je me sers.
Exercice complémentaire. — Lettre à La Fontaine où vous
discutez ses idées sur l'intelligence des animaux^ en vous appuyant
sur des exemples.
ÉPILOGUE
Source. — L’épilogue des Géorgiques de Virgile.
Intérêt. — Quand il écrivit cet épilogue, en 1679, comme quand
il écrivit l’épilogue au livre VI en 1668, La Fontaine pensait bien
mettre le point final à son œuvre de fabuliste. En fait, il revint
à la fable pour publier son troisième recueil, qui est le livre XII
(1694). Les deux épilogues sont de tons très différents : le premier
exprime simplement le désir d’un auteur de « borner sa carrière »
dans la fable pour passer à d’autres sujets que, au fond de lui-
même, il estime peut-être plus propres à lui valoir la gloire. Mais
la gloire, une gloire éclatante, lui est venue précisément par ses
fables, et, maintenant, La Fontaine jette un coup d’œil satisfait
sur l’ensemble de son œuvre qu’il résume et caractérise ; il finit en
invitant ses imitateurs à poursuivre une carrière si bien ouverte.
Le ton est d’un homme qui a de bonnes raisons de n’être pas mé
content de soi.
C’est ainsi que ma Muse *, aux bords d’une onde pure1,
Traduisait en langue * des dieux
Tout ce que disent sous les cieux
Tant d’êtres empruntant la voix de la nature2.
Truchement * de peuples * divers, 5
Je les faisais servir d’acteurs en mon ouvrage.
Car tout parle .dans l’univers,
Il n’est rien qui n’ait son langage.
Plus éloquents chez eux 3 qu’ils ne sont dans mes vers.
1. Détail qui caractérise le décor de nature propre aux fables et le
goût du poète pour la solitude (cf. XI, 4, 18-40). — 2. C’est-à-dire,
parlant en leur langage naturel, cris, gazouillements, etc. — 3. Eux
renvoie à rien (v. 9) et à tout (v. 7), par syllepse, 24, j.