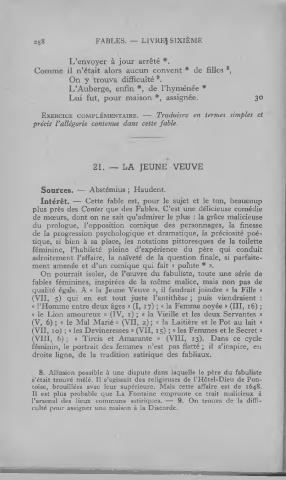Page 262 - Les fables de Lafontaine
P. 262
258 FABLES. — LIVRE} SIXIÈME
L’envoyer à jour arrêté *.
Comme il n’était alors aucun convent * de filles 8,
On y trouva difficulté 9.
L’Auberge, enfin *, de l’hyménée *
Lui fut, pour maison *, assignée. 30
Exercice complémentaire. — Traduisez en termes simples et
précis l’allégorie contenue dans cette fable.
21. — LA JEUNE VEUVE
Sources. — Abstémius ; Haudent.
Intérêt. — Cette fable est, pour le sujet et le ton, beaucoup
plus près des Contes que des Fables. C’est une délicieuse comédie
de mœurs, dont on ne sait qu’admirer le plus : la grâce malicieuse
du prologue, l’opposition comique des personnages, la finesse
de la progression psychologique et dramatique, la préciosité poé
tique, si bien à sa place, les notations pittoresques de la toilette
féminine, l’habileté pleine d’expérience du père qui conduit
adroitement l’affaire, la naïveté de la question finale, si parfaite
ment amenée et d’un comique qui fait « pointe * ».
On pourrait isoler, de l’œuvre du fabuliste, toute une série de
fables féminines, inspirées de la même malice, mais non pas de
qualité égale. A « la Jeune Veuve », il faudrait joindre « la Fille »
(VII, 5) qui en est tout juste l’antithèse ; puis viendraient :
« l’Homme entre deux âges » (I, 17) ; « la Femme noyée » (III, 16) ;
« le Lion amoureux » (IV, 1) ; « la Vieille et les deux Servantes »
(V, 6) ; « le Mal Marié » (VII, 2) ; « la Laitière et le Pot au lait »
(VII, 10) ; « les Devineresses » (VII, 15) ; « les Femmes et le Secret »
(VIII, 6) ; « Tircis et Amarante » (VIII, 13). Dans ce cycle
féminin, le portrait des femmes n’est pas flatté ; il s’inspire, en
droite ligne, de la tradition satirique des fabliaux.
8. Allusion possible à une dispute dans laquelle le père du fabuliste
s’était trouvé mêlé. Il s’agissait des religieuses de l’Hôtel-Dieu de Pon
toise, brouillées avec leur supérieure. Mais cette affaire est de 1648.
Il est plus probable que La Fontaine emprunte ce trait malicieux à
l’arsenal des lieux communs satiriques. — 9. On trouva de la diffi
culté pour assigner une maison à la Discorde.