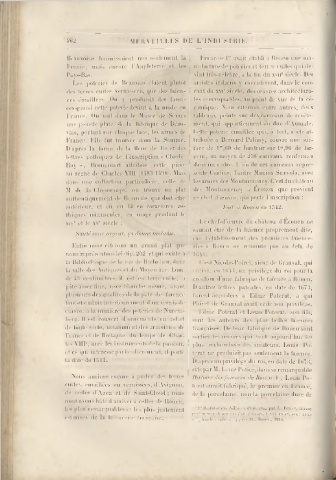Page 267 - Les merveilles de l'industrie T1
P. 267
262 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
Beauvoisis fournissaient non-seulement la François Ier avait établi à Rouen une ma
France, mais encore l’Angleterre et les nufacture de poteries et terres cuites qui de
Pays-Bas. vint très-célèbre, à la fin du xvn" siècle. Des
Les poteries de Beauvais étaient plutôt artistes italiens y exécutèrent, dans le cou
des terres cuites vernissées, que des faïen rant du xvie siècle, des œuvres architectura
ces émaillées. On y produisit des faïen les remarquables, au point de vue de la cé
ces quand cette poterie devint à la mode en ramique. Nous citerons entre autres, deux
France. On voit dans le Musée de Sèvres tableaux peints sur des carreaux de revête
une gourde plate de la fabrique de Beau ment, qui appartiennent au duc d’Aumale.
vais, portant sur chaque face, les armes de Cette poterie émaillée qui, à tort, a été at
France. Elle fut trouvée dans la Somme. tribuée à Bernard Palissy, couvre une sur
D’après la forme de la fleur de lis et des face de l“,60 de hauteur sur i",90 de lar
lettres gothiques de l’inscription « Charle- geur, au moyen de 238 carreaux renfermés
Roy », Brongniart attribue cette pièce dans un cadre. L’un de ces carreaux repré
au règne de Charles VIII (1483-1498). Mais sente Curtius, l’autre Mucius Scævola, avec
dans une collection particulière, celle de les armes des Montmorency. C’est du château
M. de la Chesnevaye, on trouve un plat des Montmorency à Ecouen que provient
authentiquement de Beauvais qui doit être ce chef-d’œuvre, qui porte l’inscription :
antérieur, et où on lit en caractères go Fait à Rouen en 1542.
thiques minuscules, en usage pendant le
xive et le xve siècle : Le chef-d’œuvre du château d’Ecouen ne
saurait être de la faïence proprement dite,
Santé sans argent, ça donne maladie.
car l’établissement des premières faïence
Enfin nous citerons un grand plat que ries à Rouen ne remonte pas au delà de
nous représentons ici (fig. 202) et qui existe à 1644.
la Bibliothèque de la rue de Richelieu, dans C’est Nicolas Poirel, sieur de Granval, qui
la salle des Antiques et du Moyen âge. Long obtint, en 1644, un privilège du roi pour la
de 43 centimètres, il est en terre cuite, à création d’une fabrique de faïence à Rouen.
pâte assez fine, assez blanche même, ayant D’autres lettres patentes, en date de 1673,
plusieurs des qualités de la pâte de faïence furent accordées à Edme Poterat, à qui
fine et enduit intérieurement d’un vernis de Poirel de Granval avait cédé son privilège.
cuivre, à la manière des poteries de Nurem Edme Poterat et Louis Poterat, son fils,
berg. Il est couvert d’ornements en relief sont les auteurs des plus belles faïences
de toute sorte, notamment des armoiries de françaises. De leur fabrique de Rouen sont
France et de Bretagne du temps de Char sorties les œuvres qui sont aujourd’hui les
les VIIIe, avec les instruments delà passion, plus recherchées des amateurs. Louis Po
et ce qui intéresse particulièrement, il porte terat ne produisit pas seulement la faïence.
la date de 1511. D’après un privilège du roi, en date de 1673,
cité par M. Louis Potier, dans sa remarquable
Nous aurions encore à parler des terres Histoire des faïences de Rouen (1), Louis Po
cuites, émaillées ou vernissées, d’Avignon, terat aurait fabriqué, le premier en France,
de celles d’Agen et de Saint-Cloud ; mais de la porcelaine, non la porcelaine dure de
nous avons hâte d’arriver à celles de Rouen,
les plus remarquables et les plus justement (1) Histoire des faïences de Rouen, par L. Potier, œuvre
posthume publiée par l’abbé Colas, 1 vol. in-4°, avec atlas
estimées de la faïencerie française. de planches coloriées, page 81. Rouen, 1870.