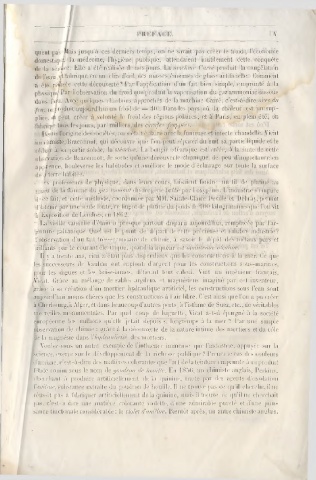Page 11 - Les merveilles de l'industrie T1
P. 11
+—------------------------------------------------------ —------------------------------------------
PRÉFACE. V
quent pas. fiais jusqu’à ces derniers temps, on ne savait pas créer le froid; l’économie
domestiqvd, la médecine, l’hygiène publique, attendaient inutilement cette conquête
de la sciifce- Elle a été réalisée de nos jours. La machine Carré produit la congélation
de l’eau, ^t fabrique en un clin d’œil des masses énormes de glace artificielle. Comment
a été réJisée cette découverte? Par l’application d’un fait bien simple, emprunté à la
physiqu • Par l’observation du froid que produit la vaporisation du gaz ammoniac dissous
dans l’cïu. Avec quelques charbons approchés de la machine Carré, c’est-à-dire avec du
feu, onproduit aujourd’hui un froid de — 30°. Dans les pays où la chaleur est un sup
plice, peut créer à volonté le froid des régions polaires ; et à Paris, en plein été, on
fabriqæ tous les jours, par milliers, des carafes frappées.
Deiuis l’origine des sociétés, on s’était éclairé avec la fumeuse et infecte chandelle. Vient
un clmiste, Braconnot, qui découvre que l’on peut séparer du suif sa partie liquide et le
rédure à sa partie solide, la stéarine. La bougie stéarique est créée, à la suite de cette
obsfvation de Braconnot; de sorte qu’une découverte chimique, de peu d’importance en
apparence, bouleverse les habitudes et améliore le mode d’éclairage sur toute la surface
de a terre habitée.
Les professeurs de physique, dans leurs cours, faisaient fondre un fil de platine au
miieu de la flamme du gaz tonnant (hydrogène brûlé par l’oxygène). L’industrie s’empare
de ce fait, et cette méthode, coordonnée par MM. Sainte-Claire Deville et Debray, permet
d’ibtenir par une seule fonte, ce lingot de platine du poids de 100 kilogrammes que l’on vit
à/Exposition de Londres, en 1862.
La vieille vaisselle d’étain a presque partout disparu aujourd’hui, remplacée par F ar
genture galvanique. Quel est le point de départ de cette précieuse et salubre industrie?
L’observation d’un fait très-secondaire de chimie, à savoir le dépôt des métaux purs et
jrillants par le courant électrique, quand la liqueur est maintenue alcaline.
Il y a trente ans, rien n’était plus dispendieux que les constructions à la mer. Ce que
les successeurs de Vauban ont englouti d’argent pour les constructions sous-marines,
pour les digues et les brise-lames, défierait tout calcul. Vint un ingénieur français,
Vicat. Grâce au mélange de sables argileux et magnésiens imaginé par cet inventeur,
grâce à sa création d’un mortier hydraulique artificiel, les constructions sous l’eau sont
aujourd’hui moins chères que les constructions à l’air libre. C’est ainsi que l’on a pu créer
à Cherbourg, à Alger, et dans beaucoup d’autres ports, à l’isthme de Suez, etc., de véritables
merveilles monumentales. Par quel coup de baguette, Vicat a-t-il épargné à la société
européenne les millions qu’elle jetait depuis si longtemps à la mer ? Par une simple
observation de chimie : grâce à la découverte de la nature intime des mortiers et du rôle
de la magnésie dans Fhydraulicilé des mortiers.
Voulez-vous un autre exemple de l’influence immense que l’industrie, appuyée sur la
science, exerce sur le développement de la richesse publique ? Prenez le cas des couleurs
d’aniline, c’est-à-dire des matières colorantes que Fart de la teinture emprunte à ce produit
fétide connu sous le nom de goudron de houille. En 4856, un chimiste anglais, Perkins,
cherchant à produire artificiellement de la quinine, traite par des agents d’oxydation
X aniline, substance extraite du goudron de houille. Il ne trouve pas ce qu’il cherche, il ne
réussit pas à fabriquer artificiellement de la quinine, mais il trouve ce qu’il ne cherchait
pas, c’est-à-dire une matière colorante violette, d’une admirable pureté et d’une puis
sance tinctoriale considérable : le violet d'aniline. Bientôt après, un autre chimiste anglais.