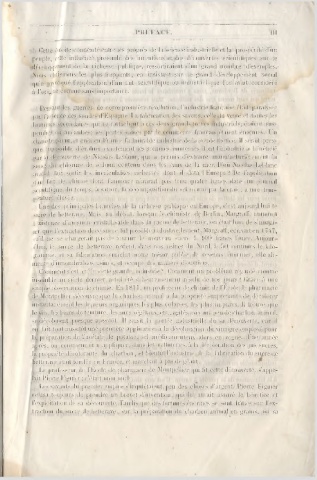Page 9 - Les merveilles de l'industrie T1
P. 9
PRÉFACE. III
Cette é^oite connexité entre les progrès de la science industrielle et la prospérité d’un
peuple, cette influence profonde des inventions et des découvertes scientifiques sur le
développement de la richesse publique, ressortiraient d’un grand nombre d’exemples.
Nous choisirons les plus frappants, en insistant sur le grand développement social
qu’a pr»voqué l’application d’un fait scientifique ou industriel que l’on avait considéré
à l’orighe comme sans importance.
Penlant les guerres de notre première révolution, l’industrie française était paralysée
par l’absence des soudes d’Espagne. La fabrication des savons, celle du verre et toutes les
brancæs secondaires qui se rattachent à ces deux grands troncs industriels, étaient sus
pendes ou anéanties; les pertes subies par le commerce français étaient énormes. Un
chimste parut, et créa en France l’admirable industrie de la soude factice. 11 serait pres
que impossible d’évaluer exactement les sommes immenses dont l’industrie a bénéficié
par la découverte de Nicolas Leblanc, qui a permis d’extraire manufacturièrement la
soûle du chlorure de sodium contenu dans les eaux de la mer. D’où Nicolas Leblanc
avat-il fait sortir les incalculables richesses dont il dota l’Europe ? De l’application
d’in fait de chimie dont l’annonce n’aurait pas tenu quatre lignes dans un journal
scientifique du temps, à savoir, la décomposition du sel marin par la craie, à une tem-
péattire élevée.
Une des principales branches de la richesse publique en Europe, c’est aujourd'hui le
sicre de betterave. Mais, au début, lorsque le chimiste de Berlin, Margraff, annonça
Existence d’un sucre cristallisable dans la racine de betterave, on était loin de s'imagi
ner que l’extraction de ce sucre fût possible industriellement. Margraff, écrivait en 1747,
cu’il ne se chargerait pas de fournir le nouveau sucre à 100 francs l’once. Aujour-
i’hui, le sucre de betterave revient, dans nos usines du Nord, à 50 centimes le kilo
gramme, et sa fabrication enrichit notre.trésor public de revenus énormes; elle ali
mente d’innombrables usines, et occupe des milliers d’ouvriers.
Comment s’est créée cette grande industrie ? Comment un problème regardé comme
insoluble au siècle dernier a-t-il été si heureusement résolu de nos jours? Grâce à une
simple observation de chimie., En 1811, un professeur de chimie de l’Ecole de pharmacie
de Montpellier découvre que le charbon animal a la propriété surprenante de décolorer
instantanément les liqueurs organiques les plus colorées, les plus impures. Il trouve que
le vin, les bains de teinture, les sucs végétaux, etc., agités avec un peu de charbon animal,
se décolorent presque aussitôt. Il saisit la portée industrielle de sa découverte, car il
en fait tout aussitôt une première application à la décoloration du vinaigre employé pour
la préparation de l’acétate de potasse, sel médicamenteux alors en vogue. Une année
après, on commençait à appliquer, dans les raffineries, à la décoloration des jus sucrés,
la propriété décolorante du charbon, et bientôt l’industrie de la fabrication du sucre de
betterave était fondée en France, et marchait à pas de géant.
Le professeur de l’École de pharmacie de Montpellier qui fit cette découverte, s’appe
lait Pierre Figuier; c’était mon oncle.
Les savants du premier empire s’inquiétaient peu des choses d’argent. Pierre Figuier
refusa toujours de prendre un brevet d’invention, qui lui aurait assuré le bénéfice et
l’exploitation de sa découverte. Tandis que des fortunes énormes se sont bâties sur l’ex
traction du sucre de betterave, sur la préparation du charbon animal en grains, ou sa