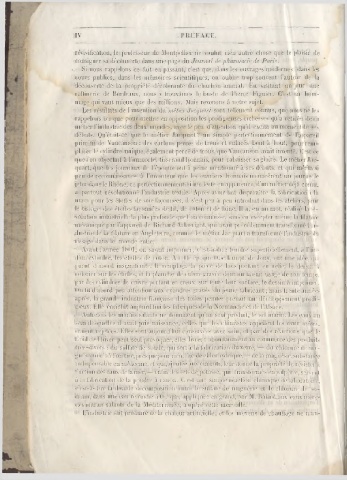Page 10 - Les merveilles de l'industrie T1
P. 10
IV PRÉFACE.
révivification, le professeur de Montpellier ne voulut rien autre chose que le plaisir de
consigner sa découverte dans une page du Journal de pharmacie de Paris.
Si nous rappelons ce fait en passant, c’est que, dans les ouvrages modernes, dans les
cours publics, dans les mémoires scientifiques, on oublie trop souvent l’auteur de la
découverte de la propriété décolorante du charbon animal. En visitant un jour une
raffinerie de Bordeaux, nous y trouvâmes le buste de Pierre Figuier. C’est un hom
mage qui vaut mieux que des millions. Mais revenons à notre sujet.
Les résultats de l’invention du métier Jacquart sont tellement connus, que nous ne les
rappelons ici que pour mettre en opposition les prodigieuses richesses qu’a retirées de ce
métier l’industrie des deux mondes, avec le peu d’attention qu’il excita au moment de ses
débuts. Qu’était-ce que le métier Jacquart? un simple perfectionnement de l’appareil
primitif de Vaucanson : des cartons percés de trous et enlacés bout à bout, pour rem
placer le cylindre unique, également percé de trous, que Vaucanson avait inventé. C’est ce
que l’on objectait à l’immortel tisserand lyonnais, pour rabaisser sa gloire. Le métier Jac
quart, que les journaux de l’époque ont à peine mentionné à ses débuts, et qui mérita si
peu de reconnaissance à l’inventeur que les ouvriers lyonnais menacèrent un jourfe le
jeter dans le Rhône, ce perfectionnement, si modeste en apparence, d’un métier déjà cornu,
a partout révolutionné l’industrie textile. Après avoir fait disparaître la fabrication i la
main pour les étoffes de soie façonnées, il s’est peu à peu introduit dans les ateliers, pjur
le tissage des étoffes façonnées de fil, de coton et de laine. Il a, en un mot, réalisé la ?é-
volution industrielle la plus profonde que l’on connaisse, sans en excepter même la filature
mécanique par l’appareil de Richard Arkwright, qui avait précédemment transformé l'in
dustrie de la filature en Angleterre, comme le métier Jacquart a transformé l’industrie du
tissage dans le monde entier.
Avant l’année 1801, on savait imprimer, c’est-à-dire teindre superficiellement, à l’aide
d’un cylindre, les étoffes de coton. A cette époque Oberkampf, de Jouy, eut une idée, qui
parut d’abord insignifiante. Il remplaça la pièce de bois portant en relief le dessin ;i
colorier sur les étoffes, et la planche de cuivre gravée dont on faisait usage de son temps,
par des cylindres de cuivre portant en creux, sur toute leur surface, le dessin à imprimer.
On fit d’abord peu attention aux cylindres gravés du jeune fabricant; mais trente années
après, la grande industrie française des toiles peintes prenait un développement prodi
gieux. Elle enrichit aujourd’hui les fabriques de la Normandie et de l’Alsace.
Autrefois les marais salants ne donnaient qu’un seul produit, le sel marin. Les eaux au
sein desquelles il avait pris naissance, celles que les chimistes appellent les eaux mères,
étaient rejetées. Elles sont aujourd’hui conservées avec soin, et par des réactions que le
froid de l’hiver peut seul provoquer, elles livrent abondamment au commerce des produits
très-divers : du sulfate de soude, qui sert à la fabrication du verre, — du chlorure de ma
gnésium d’où l’on tire,presquepour rien, l’acide chlorhydrique,— de la magnésie, substance
indispensable en médecine, et qui, ajoutée aux ciments, leur donne la propriété de résister à
l’action des eaux de la mer,— enfin des sels de potasse, qui, transformés en salpêtre, servent
à la fabrication de la poudre à canon. C’est une simple réaction chimique de laboratoire,
c’est-à-dire la double décomposition entre le sulfate de magnésie et le chlorure de so
dium, dans une eau refroidie à 0°, qui, appliquée en grand, nar M. Balard,aux eaux mères
des marais salants de la Méditerranée, a opéré cette merveille.
L’industrie sait produire de la chaleur artificielle, et les moyens de chauffage ne man