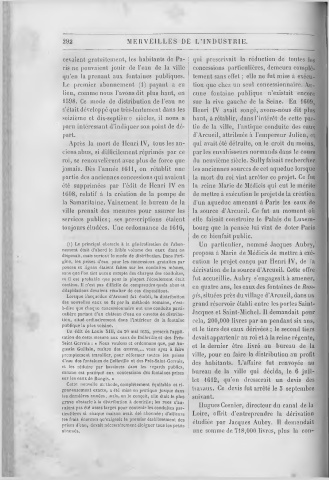Page 294 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 294
292 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
cevaient gratuitement, les habitants de Pa qui prescrivait la réduction de toutes les
ris ne pouvaient jouir de l’eau de la ville concessions particulières, demeura complè
qu’en la prenant aux fontaines publiques. tement sans effet ; elle ne fut mise à exécu
Le premier abonnement (1) payant a eu tion que chez un seul concessionnaire. Au
lieu, comme nous l’avons dit plus haut, en cune fontaine publique n’existait encore
1698. Ce mode de distribution de l’eau ne sur la rive gauche de la Seine. En 1609,
s’était développé que très-lentement dans les Henri IV avait songé, avons-nous dit plus
seizième et dix-septième siècles, il nous a haut, à rétablir, dans l’intérêt de cette par
paru intéressant d’indiquer son point de dé tie de la ville, l’antique conduite des eaux
part. d’Arcueil, attribuée à l’empereur Julien, et
Après la mort de Henri IV, tous les an qui avait été détruite, on le croit du moins,
ciens abus, si difficilement réprimés par ce par les envahisseurs normands dans le cours
roi, se renouvelèrent avec plus de force que du neuvième siècle. Sully faisait rechercher
jamais. Dès l’année 1611, on rétablit une les anciennes sources de cet aqueduc lorsque
partie des anciennes concessions qui avaient la mort du roi vint arrêter ce projet. Ce fut
été supprimées par l’édit de Henri IV en la reine Marie de Médicis qui eut le mérite
1608, relatif à la création de la pompe de de mettre à exécution le projet de la création
la Samaritaine. Vainement le bureau de la d’un aqueduc amenant à Paris les eaux de
ville prenait des mesures pour assurer les la source d’Arcueil. Ce fut au moment où
services publics ; ses prescriptions étaient elle faisait construire le Palais du Luxem
toujours éludées. Une ordonnance de 1616, bourg que la pensée lui vint de doter Paris
de ce bienfait public.
(I) Le principal obstacle à la généralisation de l’abon Un particulier, nommé Jacques Aubrv,1
nement était d’abord le faible volume des eaux dont on
disposait, mais surtout le mode de distribution. Dans l’ori proposa à Marie de Médicis de mettre à exé
gine, les prises d’eau pour les concessions gratuites par cution le projet conçu par Henri IV, de la
pouces et lignes étaient faites sur les conduites mêmes,
sans que l’on tînt aucun compte des charges des conduites, dérivation de la source d’Arcueil. Cette offre
et il est probable que pour la plupart l’écoulement était fut accueillie. Aubry s’engageait à amener,
continu. Il n’est pas difficile de comprendre quels abus et en quatre ans, les eaux des fontaines de Run-
dilapidations devaient résulter de ces dispositions.
Lorsque l’acqueduc d’Arcueil fut établi, la distribution ffis, situées près du village d’Arcueil, dans un
des nouvelles eaux se fit par la méthode romaine, c’est- grand réservoir établi entre les portes Saint-
à-dire que chaque concessionnaire eut une conduite parti
culière partant d’un château d’eau ou cuvette de distribu Jacques et Saint-Michel. 11 demandait pour
tion, situé ordinairement dans l’intérieur de la fontaine cela, 200,000 livres par an pendant six ans,
publique la plus voisine.
Un édit de Louis XIII, du 2<’> mai 1635, prescrit l’appli et le tiers des eaux dérivées ; le second tiers
cation de cette mesure aux eaux de Belleville et des Prés- devait appartenir au roi et à la reine régente,
Saint-Gervais : « Nous voulons et ordonnons que, par Au
gustin Guillain, maître des œuvres,... vous ayez à faire et le dernier être livré au bureau de la
promptement travailler, pour réformer toutes les prises ville, pour en faire la distribution au profit
d’eau des fontaines de Belleville et des Prés-Saint-Gervais, des habitants. L’affaire fut renvoyée au
et les réduire par bassinets dans les regards publics,
comme est pratiqué aux concessions des fontaines prises bureau de la ville qui décida, le 6 juil
sur les eaux de Rungis. » let 1612, qu’on dresserait un devis des
Cette nouvelle méthode, complètement équitable et ri
goureusement exacte, a été mise en pratique jusque dans travaux. Ce devis fut arrêté le 5 septembre
les dernières années; mais, on le conçoit, elle était le plus suivant.
grave obstacle à la distribution à domicile; les rues n’au
raient pas été assez larges pour contenir les conduites par Hugues Cosnier, directeur du canal de la
ticulières si chaque maison avait été abonnée; d’ailleurs Loire, offrit d’entreprendre la dérivation
les frais énormes qu’exigeait le premier établissement des
prises d’eau, devait nécessairement éloigner tous les petits étudiée par Jacques Aubry. Il demandait
abonnés. une somme de 718,000 livres, plus la con-