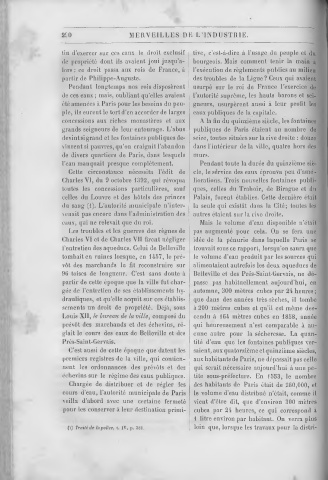Page 292 - Les merveilles de l'industrie T3 Web
P. 292
210 MERVEILLES DE L’INDUSTRIE.
tin d’exercer sur ces eaux le droit exclusif tive, c’est-à-dire à l’usage du peuple et du
de propriété dont ils avaient joui jusqu’a bourgeois. Mais comment tenir la main à
lors : ce droit passa aux rois de France, à l’exécution de règlements publics au milieu
partir de Philippe-Auguste. des troubles de la Ligue ? Ceux qui avaient
Pendant longtemps nos rois disposèrent usurpé sur le roi de France l’exercice de
de ces eaux ; mais, oubliant qu’elles avaient l’autorité suprême, les hauts barons et sei
été amenées à Paris pour les besoins du peu gneurs, usurpèrent aussi à leur profit les
ple, ils eurent le tort d’en accorder de larges eaux publiques de la capitale.
concessions aux riches monastères et aux A la fin du quinzième siècle, les fontaines
grands seigneurs de leur entourage. L’abus publiques de Paris étaient au nombre de
devint si grand et les fontaines publiques de seize, toutes situées sur la rive droite : douze
vinrent si pauvres, qu’on craignit l’abandon dans l’intérieur de la ville, quatre hors des
de divers quartiers de Paris, dans lesquels murs.
l’eau manquait presque complètement. Pendant toute la durée du quinzième siè
Cette circonstance nécessita l’édit de cle, le service des eaux éprouva peu d’amé
Charles VI, du 9 octobre 1392, qui révoqua liorations. Trois nouvelles fontaines publi
toutes les concessions particulières, sauf ques, celles du Trahoir, de Birague et du
celles du Louvre et des hôtels des princes Palais, furent établies. Cette dernière était
du sang (1). L’autorité municipale n’inter la seule qui existât dans la Cité; toutes les
venait pas encore dans l’administration des autres étaient sur la rive droite.
eaux, qui ne relevait que du roi. Mais le volume d’eau disponible n’était
Les troubles et les guerres des règnes de pas augmenté pour cela. On se fera une
Charles VI et de Charles Vil firent négliger idée de la pénurie dans laquelle Paris se
l’entretien des aqueducs. Celui de Bellevillc trouvait sous ce rapport, lorsqu’on saura que
tombait en ruines lorsque, en 1457, le pré le volume d’eau produit par les sources qui
vôt des marchands le fit reconstruire sur alimentaient autrefois les deux aqueducs de
96 toises de longueur. C’est sans doute à Belleville et des Prés-Saint-Gervais, ne dé
partir de cette époque que la ville fut char passe pas habituellement aujourd’hui, en
gée de l’entretien de ses établissements hy automne, 300 mètres cubes par 24 heures;
drauliques, et qu’elle acquit sur ces établis que dans des années très-sèches, il tombe
sements un droit de propriété. Déjà, sous à 200 mètres cubes et qu’il est même des
Louis XII, le bureau de la ville, composé du cendu à 164 mètres cubes en 1858, année
prévôt des marchands et des échevins, ré qui heureusement n’est comparable à au
glait le cours des eaux de Belleville et des cune autre pour la sécheresse. La quan
Prés-Saint-Gervais. tité d’eau que les fontaines publiques ver
C’est aussi de cette époque que datent les saient, aux quatorzième et quinzième siècles,
premiers registres de la ville, qui contien aux habitants de Paris, ne dépassait pas celle
nent les ordonnances des prévôts et des qui serait nécessaire aujourd’hui à une pe
échevins sur le régime des eaux publiques. tite sous-préfecture. En 1553, le nombre
Chargée de distribuer et de régler les des habitants de Paris était de 260,000, et
cours d’eau, l’autorité municipale de Paris le volume d’eau distribué n’était, comme il
veilla d’abord avec une certaine fermeté vient d’être dit, que d’environ 300 mètres
pour les conserver à leur destination primi- cubes par 24 heures, ce qui correspond à
1 litre environ par habitant. On verra plus
(1) Traité de la police, t. IV, p. 381. I loin que, lorsque les travaux pour la distri