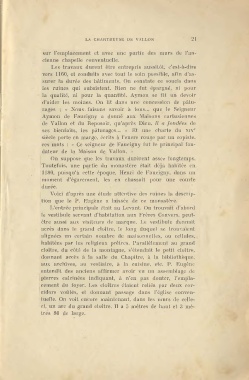Page 23 - Chartreuse de Vallon
P. 23
LA CHARTREUSE DE VALLON 21
sur l'emplacement et avec une partie des murs de l'an-
cienne chapelle conventuelle.
Les travaux durent être entrepris aussitôt, c'est-à-dire
vers 1160, et conduits avec tout le soin possible, afin d'as-
surer la durée des bâtiments. On constate ce soucis dans
les ruines qui subsistent. Rien ne fut épargné, ni pour
la qualité, ni pour la quantité. Aymon se fit un devoir
d'aider les moines. On lit dans une concession de pâtu-
rages : « Nous. faisons savoir à tous ... que le Seigneur
Aymon de Faucigny a donné aux :\faisons cartusiennes
de Vallon et du Reposoir, qu'après Dieu, il a fondées de
ses bienfaits, les pâturages... ,, Et une charte du xrv•
siècle porte en marge, écrits à l'encre rouge par un copiste.
ces mots : << Ce seigneur de Faucigny fut le principal fon-
dateur de la Maison de Vallon. "
On suppose que les travaux durèrent assez longtemps.
Toutefois, une partie du monastère était déjà habitée en
1180, puisqu'à cette époque, Henri de Faucigny, dans un
moment d'égarement, les en chassait pour une courte
durée.
Voici d'après une étude attentive des ruines la descrip-
tion que le P. Eugène a laissée de ce monastère.
L'entrée principale était au Levant. On trouvait d'abord
le vestibule servant d'habitation aux Frères Convers, peut-
être aussi aux visiteurs de marque. Le vestibule donnait
accès dans le grand cloître, le long duquel se trouvaient
alignées un certain nombre de maisonnettes, ou cellules,
habitées par les religieux prêtres. Parallèlement au grand
cloître, du côté de la montagne, s'étendait le petit cloître,
donnant accès à la salle du Chapitre, à la bibliothèque,
aux archives, au vestiaire, à la cuisine, etc. P. Eugène
entendit des anciens affirmer avoir vu un assemblage de
pierres calcinées indiquant, à n'en pas douter, l'empla-
cement du foyer. Les cloîtres étaient reliés par deux cor-
ridors voûtés, et donnant passage dans l'église conven-
tuelle. On voit encore maintenant, dans les murs de celle-
ci, un arc du grand cloître. Il a 5 mètres de haut et 3 mè-
tres 80 de large.