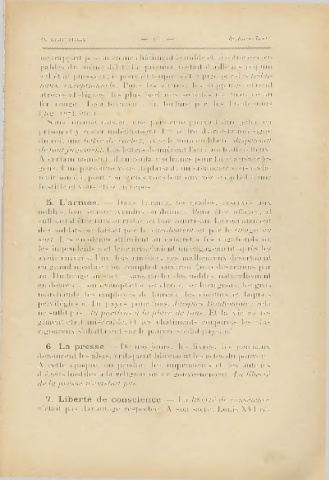Page 149 - Histoire de France essentielle
P. 149
I il Histoire-Texte.
AU XVIII'' SIÈCLE.
ne frappait pas «lu même châtiment le noble et le roturier cou
pables tlu même délit.’ Le premier restait d’ailleurs impuni
s’il était puissant : il pouvait toujours être jugé par des tribfi
naux exceptionnels. Pour les autres, les supplices étaient
atroces et dignes des plus barbares sociétés (la marque au
fer rouge, récarlèlemeiil . la torture par les brodequins
(//g'. 127), etc.).
Sans aucune raison, une personne pouvait être jetée en
prison et y rester indéfiniment. Un ordre d'arrestation signé
du roi. une lettre de cachet, avec le nom en blanc, dispensait
de tout jugement. Ces lettres donnèrent lieu à un trafic odieux.
A certain moment, il en coûta 120 francs pour faire arrêter les
gens. Une personne vous déplaisait, un créancier vous récla
mait son dû, pour 120 francs vous leur'ouvriez le cachot d’une
bastille et vous étiez en repos.
5. L’armée. Dans l’armée, les grades, réservés aux
nobles, leur étaient vendus ou donnés. Pour être officier, il
suffisait d’être titré et riche, ou bon courtisan. Le recrutement
des soldats se faisait par le racolement et par le tirage au
sort. Les racoleurs attiraient au cabaret « les vagabonds ou
les imprudents » et leur arrachaient un engagement après les
avoir enivrés. Une fois enrôlés, ces malheureux désertaient
en grand nombre : 011 comptait environ 4doo désertions par
an. Du tirage au sort— sans parler des nobles, naturellement
en dehors — on exemptait « les clercs, les bourgeois, les gros
marchands, les employés de bureau, les commis et .laquais
privilégiés ». Tu payes pour tous, Jacques Bonhomme ; cela
ne suffit pas : tu partiras à la place de tous. Et la vie au ré
giment était misérable, et les châtiments corporels les plus
rigoureux s’abattaient sur le pauvre soldat paysan !
6. La presse. — De nos jours, les livres, les journaux
dénoncent les abus, critiquent librement les actes du pouvoir.
A cette époque, on pendait les imprimeurs et les auteurs
d’écrits hostiles à la religion ou au gouvernement. La liberté
de la presse n'existait pas.
7. Liberté de conscience. — La liberté de conscience
n’était pas davantage respectée'. A son sacre, Louis XVI ré